THOMAZEAU, A. & JUHEL, N. (dir.) (2012), Inégalités scolaires et résilience, Retz (293 p., 17euros)., par Marlène LEBRUN
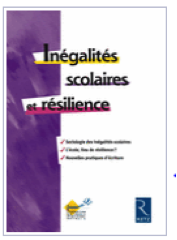 Lire la note de lecture en format doc
Lire la note de lecture en format doc
Il n’est pas question de résumer chacune des 13 contributions de cet ouvrage car non seulement la place manquerait mais surtout au-delà de l’apport de chacun des auteurs, chercheurs nourris par la pratique, ce serait occulter la dynamique de cet ouvrage dont le titre éclaire les contributions quelle que soit l’origine des auteurs, la nature des recherches et des publics d’apprenants convoqués. L’enjeu de cette note de lecture est de mettre en appétit de lecture pour un ouvrage percutant, volontiers iconoclaste, qui invite à penser la question des inégalités d’apprentissage d’un triple point de vue sociologique, linguistique et surtout didactique, afin de construire des solutions efficaces pour réduire et limiter les inégalités scolaires dans une école démocratique plus juste et plus efficace.
Le terme de résilience qui apparait dans le titre ne figure dans aucune des contributions dont il est pourtant le fil rouge fédérateur. Il rappelle que l’énumération des causes des inégalités scolaires ne suffit pas et que pour en prendre la mesure, il faut analyser la nature des difficultés et des résistances des publics démunis qui ne comprennent pas les attentes scolaires et ne peuvent donc réussir à l’école. L’ouvrage présente deux parties, l’une sur les aspects sociologiques des difficultés scolaires et l’autre sur ce qui fait la spécificité de l’école, l’acculturation écrite et la question de la construction de l’écrit qui permet aussi de se construire comme sujet sur les plans cognitif et affectif.
Georges Felouzis montre que si le niveau des élèves a régulièrement monté jusqu’aux années 90 (Baudelot et Establet, Le niveau monte, 1989), il baisse en France chez les élèves les plus faibles dont l’écart avec les meilleurs se creuse de plus en plus. Dans PISA 2009, la France est le second pays le plus inégalitaire au plan de la corrélation entre les résultats et l’origine socio-économique des élèves. Les sociologues cités montrent que l’accroissement des inégalités scolaires est le fruit d’une politique éducative élitiste républicaine qui sélectionne trop tôt les élèves. Un système éducatif capable de limiter les inégalités d’acquis entre les groupes sociaux remplit trois conditions : l’ouverture du système où l’âge de la première orientation est la plus tardive (entre 14 et 16 ans), la limitation des filières à 15 ans à une ou deux et un degré faible de ségrégation académique et sociale des établissements. Si l’exemple finlandais est souvent mis en exergue, c’est qu’il est à l’opposé du système français avec une ségrégation sociale inexistante, un redoublement très rare et un enseignement très individualisé.
Après ces constats qui disent l’urgence d’une démocratisation réelle de l’école française, Christophe Thoumy et Colette Catteau parlent de l’invisibilité des savoirs qui génèrent l’invisibilité des difficultés. Les élèves en difficultés sont (et/ou peuvent être mis) dans une logique de tâche et non dans une logique de savoir et ce malentendu est à l’origine d’une logique de réussite immédiate et non d’une logique de compréhension ; les élèves en difficultés travaillent souvent beaucoup sans apprendre car « ils restent à la surface des tâches à accomplir sans être incités à penser, à réfléchir de manière autonome » (p. 28) . La logique qui consiste à séparer compétences et connaissances en privilégiant des savoir-faire, sans insister sur ce qu’il importe de comprendre, est de plus en plus ordinaire dans les pratiques. Il ne s’agit pas simplement ou seulement de motiver l’activité scolaire mais de faire comprendre que l’apprentissage suppose une distanciation et une objectivation des savoirs mobilisés. Des pratiques d’enseignement qui ne permettent pas aux élèves d’apprendre ensemble les isolent précocement dans des tâches individuelles ; il apert aussi que les pratiques évaluatives de compétences deviennent souvent un enjeu et se substituent aux programmes d’enseignement officiels. Pour passer de l’activisme, lié à un faire, à l’activité scolaire, pensée comme une activité cognitive spécifique à l’école, il est loisible de permettre aux élèves de penser les tâches et pas simplement de les réaliser ; l’acquisition de connaissances passe par la maitrise d’un processus et la capacité à raisonner et non par la simple addition de savoirs capitalisables.
Pierre Périer fait apparaitre la manière dont l’école disqualifie les familles populaires qui ne comprennent pas les attentes et les implicites scolaires. La bonne volonté parentale ne suffit pas pour optimiser l’aide aux devoirs. Parfois même, le fait que l’aide parentale ne soit guère possible dépossède les parents de leur autorité éducative face à des enfants trop tôt autonomes. De plus, l’imputation à la famille, jugée absente ou incapable, des difficultés scolaires de l’enfant, déresponsabilise et dédouane l’école de ses erreurs.
Marie-Christine Toczek-Capelle rappelle l’importance de l’estime de soi sur la réussite des élèves et le poids des représentations liées aux disciplines, à l’évaluation et aux genres sexués. Il importe que les enseignants fassent passer l’idée selon laquelle l’intelligence évolue grâce aux efforts : les élèves qui croient que celle-ci est liée au don obtiennent de moins bonnes performances que ceux qui croient au mérite.
Si le système scolaire traite de manière égalitaire tous les élèves quelles que soient leurs inégalités initiales devant la culture, ces inégalités évoluent faute de discrimination positive. Ainsi l’effet-maitre a-t-il une importance capitale dans le devenir des élèves et la réduction des inégalités. Une école plus ouverte, plus coopérative, moins élitiste devient une école pour tous qui promeut la réussite du plus grand nombre ; la FNAME (fédération nationale des associations de maîtres E) ne cesse de le rappeler ; Laurent Lescouarch explicite la posture d’accompagnement du maitre qui suppose étymologiquement une double dimension de relation et de cheminement : être avec et aller vers sur la base d’une valeur symbolique, celle du partage. Sur le plan pédagogique, cela suppose un basculement des pratiques pédagogiques et une prise en compte de l’enfant dans sa globalité, avec le développement de pratiques collaboratives entre des acteurs aux habitus de travail très différents. Cela suppose aussi de dénoncer le mythe scolaire de la reprise après-coup des notions et celui du petit effectif et de l’individualisation qui agirait comme « par nature ».
La transition avec la seconde partie de l’ouvrage, qui traite de la didactisation des solutions permettant de limiter les inégalités scolaires et l’accès à la culture écrite pour tous, est évidente. C’est l’acculturation écrite qui est l’enjeu de la culture scolaire.
Pierre Billoet pose d’emblée la question de la conception de l’écriture conçue comme un lieu de réception du sens constitué dans un langage situé hors d’elle (dans la pensée ou la vie sociale) ou, au contraire, un lieu de construction du sens consubstantiel à sa fonction communicationnelle. Autrement dit, l’écriture n’est pas une transcription mais une production. Goody a mis en évidence la manière dont l’écriture permet la construction de soi. Ainsi l’écriture n’est-elle pas seulement une forme de communication du savoir, mais le lieu même de sa constitution. Dans l’écriture manuscrite, il y a trois moments en tension : tracer, comprendre et coder. Dans l’écriture spéculaire (sur écran), le premier moment disparait et le texte sur écran ne laisse pas de trace tangible personnelle puisqu’il peut être modifié par le lecteur présent et à venir ; le passage à l’écriture spéculaire affecte la construction de soi en jeu dans l’écriture manuscrite. Si la culture du livre a institué le sacre de l’écrivain, la culture numérique, dans sa dimension anthropologique, inaugure la renaissance du lecteur. Il importe que les acteurs de l’école prennent acte des différences importantes entre l’encre et l’électron dans le développement de la pensée et de l’individu et que l’apprentissage de l’écriture informatique soit assuré par des enseignants et non des industriels si l’on souhaite que l’apprentissage de l’écriture vise la culture de l’autonomie.
C’est en hommage à Dominique Bucheton que Jean-Charles Chabanne présente une réflexion didactique sur la construction de soi par l’écrit pour penser et apprendre. La didacticienne a inscrit la recherche dans des valeurs, la confiance dans les ressources des élèves et dans l’inventivité de leurs enseignants, le parti pris que le savoir est d’abord un savoir d’action, que la théorie décrit, accompagne, amplifie mais qu’elle ne dirige pas d’autorité. Par ses fonctions intellectuelles, sociales et symboliques, l’écriture est avant tout une activité sur sa pensée et sur autrui qui suppose donc une prise de risque identitaire. L’enseignant n’est pas seulement un entraineur mais un supporter qui encourage. Il importe donc de donner sa vraie place aux écrits intermédiaires, dans toutes les acceptions, entre deux états d’un écrit, entre deux états de pensée, entre les pairs, entre de l’écrit et de l’oral….
Pour Jean-Pierre Kamienak, il faut appréhender l’apprenant dans sa globalité, pas seulement comme un sujet cognitif mais un enfant en situation d’apprentissage, un sujet, une personne, un être psychoaffectif singulier engagé dans un tissu relationnel qui lui permet de se construire. Ainsi l’écriture peut-elle être un espace fort de sublimation pour le sujet libidinal qui écrit.
Pour Jean-Marc Champeaux et Jean-Paul Robert, membres du GFEN (Groupe Français d’Éducation Nouvelle), il faut écrire pour apprendre à lire. La source créative de l’atelier d’écriture qui s’enracine et se nourrit du collectif produit du singulier. L’écriture n’est pas l’expression de la pensée mais une forme de pensée. Dans l’atelier d’écriture, l’activité est conçue comme moteur de la motivation qui devient une conséquence et non un préalable à l’apprentissage.
André Ouzoulias et Jean-Paul Fischer prouvent le rôle déterminant d’une première compréhension de la graphophonologie au niveau syllabique pour réussir l’apprentissage de la lecture. La conception didactique classique, qui fait de l’accès aux phonèmes un prérequis sensoriel avant toute exploration des mots écrits, est génératrice des difficultés d’apprentissage de la lecture des élèves les plus vulnérables. Plus que la conscience phonologique, le niveau de vocabulaire et le quotient intellectuel, c’est l’identification des lettres qui se révèle le meilleur prédicteur de la réussite de l’apprentissage en question ; la conscience des phonèmes et la connaissance des graphèmes ne se succèdent pas mais interagissent dans un développement en va-et-vient. La syllabe écrite et la connaissance des lettres sont l’instrument psychologique de la découverte des phonèmes dans la syllabe orale ; sans support écrit, les exercices de métaphonologie ne permettent pas le développement de la clarté cognitive sur l’apprentissage de la lecture. Il découle de cela que les démarches pédagogiques doivent aborder d’emblée les activités métaphonologiques en s’appuyant sur les mots écrits. Les activités d’écriture qui nécessitent d’épeler conduisent les élèves à mieux discerner les lettres et les aident à faire le lien entre les activités métaphonologiques (discrimination auditive) et l’apprentissage de la lecture. Les élèves comprennent alors que l’écriture note le langage et comment elle le fait. De tous les entrainements en grande section, le plus efficace est celui qui conduit les enfants à mettre en relation les graphies et les phonies et non à faire de simples exercices métaphonologiques sur des stimuli auditifs. La compréhension du principe alphabétique sans laquelle l’apprentissage de la lecture ne peut réussir sera facilitée par une pédagogie où l’écriture est aussi importante que la lecture.
Dans un titre percutant, Jeanne Dion affirme que tous les élèves sont capables de faire de la grammaire, c’est-à-dire de construire une posture de réflexivité sur la langue. Il importe donc que l’élève bascule d’une posture de lecteur qui s’attache au sens du message à une posture de grammairien qui étudie le fonctionnement de la langue. Bernard Lahire a montré que les élèves en difficulté utilisent la langue dans une perspective dialogique pour parler et communiquer alors que l’école attend une perspective monologique impliquant de travailler la phrase comme un objet étudiable en soi, ce qui implique de la décontextualiser et de la « désémantiser », tout au moins pour un temps. L’auteure prend l’exemple de la construction du concept d’antériorité qui est nodal dans la découverte du secret de fabrication des temps composés de tous les modes. Loin des pratiques transmissives du savoir, il faut conduire l’élève à se questionner. Ainsi l’apprentissage de l’orthographe passe-t-il par la redécouverte des codes de l’écrit que les hommes ont dû inventer pour répondre aux problèmes concrets rencontrés dans leurs essais successifs de communication. Ceux-ci constituent l’expérience historique de l’humanité et les aptitudes intellectuelles construites en lien.
Il en résulte qu’il faut faire un choix entre des pratiques prescriptives axées sur la norme et des pratiques qui considèrent les élèves « comme des sujets capables de devenir eux-mêmes les maîtres de la langue, la leur, celle des autres, celle des livres, à l’oral comme à l’écrit, pour savoir et pour créer » (p.277).
Au total, cet ouvrage stimulant et actuel invite le lecteur, le parent, le formateur, le pédagogue, le didacticien, le praticien réflexif, à se poser des questions sur l’éducation qu’il souhaite. Sera-t-elle au service de la réussite de tous, comme le préconisait déjà l’humaniste Comenius au XVIème siècle ? Le titre de son ouvrage La grande didactique a donné son nom à la jeune discipline de recherche qu’est la didactique, dont se réclament les contributions de la seconde partie qui présentent des pistes ou des savoirs d’action mis à l’épreuve de la pratique. L’auteure de cette note de lecture s’inscrit résolument dans une perspective d’éducation libératrice qui émancipe et autonomise l’élève pour qu’il accède au statut de sujet de culture dans un monde d’intelligences partagées où le questionnement ne s’épuise jamais.
Ce livre roboratif est riche et porteur d’espoir car les auteurs ont su prendre à bras le corps certaines représentations, évidences partagées et naturalisées, ou démarches pédagogiques qui sont à l’origine des difficultés des plus démunis ou vulnérables. Encore faut-il que l’école accepte de porter un regard neuf sur les difficultés scolaires, non de lamentation mais d’objectivation des problèmes dont l’origine est le plus souvent dans les pratiques d’enseignement-apprentissage.

